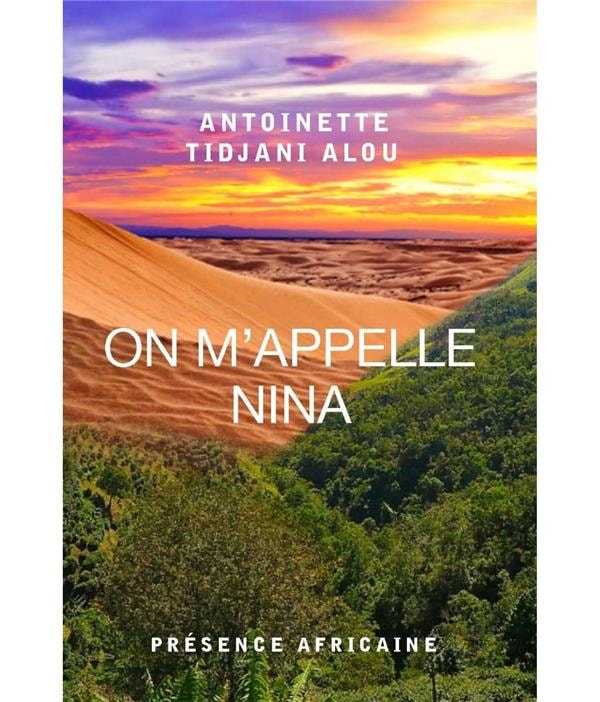Littérature / On m’appelle Nina / Un journal intime dans l’anonymat / Antoinette Tidjani Alou.
L’œuvre est du Pr Antoinette Tidjani Alou, une œuvre inédite au Niger, « Autofiction », un genre rare en littérature d’ailleurs. Le sujet l’est tout aussi.
Raconté par Nina – la narratrice – On m’appelle Nina est un roman paru en 2017 aux Edition Présence Africaine. C’est le témoignage touchant d’une femme qui, sur une proportion importante de la frise de sa vie, relate les points saillants d’un destin qui force l’admiration. Un parcours singulier qui l’a amenée de sa Jamaïque natale, à vivre au Niger depuis plus de vingt ans, à partir de la France où elle a séjourné pour des études de lettres mais surtout où elle est tombée sous le charme sahélien du Nigérien dont elle porte aujourd’hui le nom (Ali dans l’œuvre), à l’époque jeune et très brillant étudiant. Antoinette Tidjani Alou (alias Nina) propose dans ce texte un tableau critique des modes de vie des Nigériens et passe du choc culturel à l’émerveillement devant une culture qui ne peut laisser indifférent.
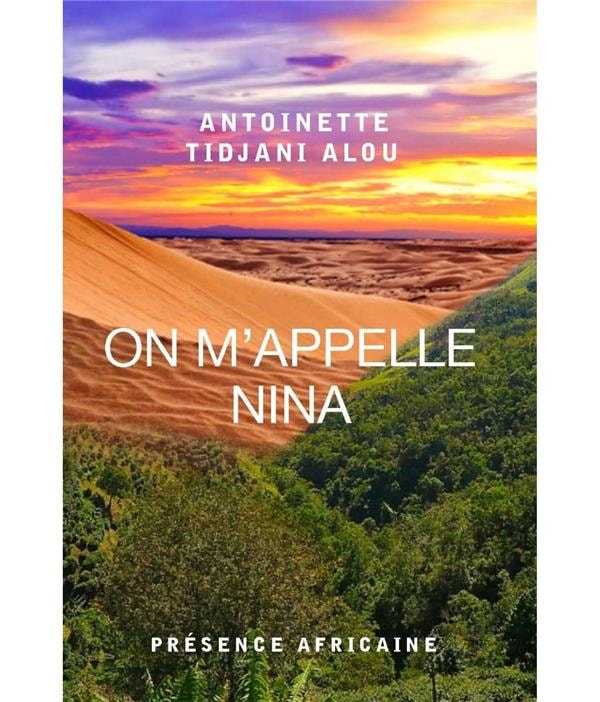
Dans ce récit, qui tient en haleine le lecteur le plus averti, dès le début, et sur toute une dizaine de pages, l’enseignante chercheure et écrivaine rabâche le mot ‘‘étranger’’ comme dans cette éloquente répétition « l’étranger ne comprend pas, l’étranger ne voit que ce qu’il connait déjà. L’étranger sera toujours étranger et étrange » (Page 09). Pour le lecteur, le décor est planté : c’est l’histoire d’une étrangère, celle que l’auteure a été au Niger, l’étrangère qu’elle s’est sentie, à son arrivée, dans ce pays où tout était nouveau pour elle, presque. Mais aussi l’étrangère qu’elle a voulu, un peu trop longtemps, restée, s’empêchant ainsi et sans doute, de tôt réaliser que l’hospitalité africaine est loin d’être une légende au Niger et donc de vite s’y sentir comme un poisson dans l’eau. Dans la tradition haoussa qui est celle de sa famille adoptive, un adage dit : Bako na kwana biu ne ; traduction : « on est étranger que deux jours » !
Plus loin, Nina, la narratrice – qui n’est ni le nom de l’auteure, ni un surnom, mais le nom de sa belle-sœur-chérie – se souvient comment elle apparaissait bizarre aux yeux des Nigériennes ; au lieu de fleurs, ce sont des épis qu’elle met ses pots et décore son salon de façon bizarre. Au passage, elle raille « le manque de bienséances » de certaines personnes d’ici qui n’hésitent pas à rendre visite aux heures de repas, sans être conviés au préalable, sans être prévus. « Toujours des bouches imprévues à nourrir » (Page 14). Cela est inadmissible dans son pays. Certaines filles de sa belle-famille vont jusqu’à franchir la porte de sa cuisine, sans y être autorisées pour mettre la louche dans la sauce, sa sauce à elle.
Quel scandale ! On ne peut rien préparer pour soi seul, ici, rien que pour soi. Heureusement, Ali (son époux) est là pour lui apprendre les règles, la règle en matière de famille et d’hôte au Niger : « ce qui suffit pour deux personnes, doit suffire pour trois », il n’y a qu’à allonger la sauce un peu, il faut ajouter de l’eau.
La critique de nos mœurs dans cette œuvre est plus acerbe contre le « Ya kamata ». Au Niger, pour toute chose il y a un idéal, une norme, une voie à suivre : le ya kamata. Il faut supporter sa belle-famille, ne jamais gémir pour elle quoi qu’il en soit, il faut composer avec les voisins, il ne faut pas s’habiller comme ça. Et Nina de se plaindre : « se frayer un horizon plus large dans un monde balisé exagérément de ya kamata, d’il faut, il faut, n’est ni facile, ni gratuit » (Page 87). Pour le commun des Nigériens cette critique ne peut passer. Le ya kamata a fait et continue de faire ses preuves. Par exemple, si dans le temps, un homme pouvait épouser une femme choisie, pour lui, par ses parents, sans demander son avis, et rester avec elle, pendant 40, 50 ans voire toute sa vie (ce qui est rare, aujourd’hui où on se choisit) sans divorce ni problème qui mérite séparation, c’est par la force de ce ya kamata. Interrogée sur cette question de choix du conjoint, la journaliste et réalisatrice nigérienne, Ramatou Keita a répondu à Yasmin Chouaki, dans son émission En sol majeur de la Radio France Internationale, rfi : « dans ma famille, tous les mariages arrangés ont perduré ».
Le manque de professionnalisme, l’esprit mercantile, bref les atteintes graves à la déontologie de certains agents des services publiques sont d’autres tares des Nigériens que la Jamaïcaine relève et condamne à raison. Dans un Niger des années 90, cette période des vaches maigres où le pays a pratiquement sombré sous un régime en perte de repère après la disparition non préparée de son chef charismatique et agenouillé par les coups de boutoir de partenaires financiers sans morale à travers les diaboliques Programmes d’Ajustement Structurel P.A.S, il n’était pas rare, d’avoir affaire à « des infirmiers bourrus, pas tendres » dans les centres de santé. L’autre vérité historique qui blesse, à en croire Nina, c’est la démission de l’Etat, carrément, dans un pays où tout manque pratiquement ; l’expression ‘‘arriérés de salaire’’ était devenue banale à l’époque. Si les salaires sont réguliers aujourd’hui, l’accueil est-il plus aimables dans nos ministères ou nos écoles ? N’est-ce pas pire dans nos centres de santé ? Mme Tidjani Alou, elle, appelle à tout changer, jusqu’au nom du pays. Sahelia, voilà ce qu’elle propose pour remplacer Niger, qui crée trop la confusion avec le Nigeria. Sahelia, parce qu’on est au cœur du Sahelia, cette région de grand soleil ; « Les Sahéliens ont attelé le soleil à leur char » (Page 124).
Mais Nina ne peut s’empêcher d’admettre la beauté de certaines pratiques sociales nigériennes : les solutions toujours pratiques et efficaces aux problèmes du quotidien, la solidarité des uns dans la joie comme dans la peine des autres, la littérature étendue et admirable. Emerveillée par l’esthétique des langues du Niger, elle aligne, dans son récit, les proverbes et autres adages facilement appris parce que beaux et pâlissants. Pour finir par témoigner : « ici, le proverbe bien placé vaut cher ».
Finalement, pour le lecteur, ce roman qui, au début, semble être, le lieu de dénonciation de tout ce que l’auteure a relevé comme travers dans nos us et coutumes, s’avère pratiquement une déclaration d’amour pour des cultures qui surprennent certes la première fois, mais des cultures qui convainquent et plaisent. Des cultures qui enchantent tout simplement l’auteur, une fille de Jamaïque, que le destin mais surtout l’amour a conduit chez nous, le Niger, un pays dont elle ignorait jusqu’à l’existence.
Naturalisée Nigérienne, Antoinette Tidjani Alou est enseignante chercheure à l’Université Abdou Moumouni de Niamey. Elle est Maitre de conférences en littérature comparée et Coordinatrice de la filière Arts et Culture de cette même université. Depuis 2017, date de parution du roman On m’appelle Nina, elle a agrandi la famille des écrivains nigériens. Antoinette Tidjani Alou écrit en Français et en Anglais, sa langue maternelle.
ABA-mag’
Hamidou Idrissa Moussa
Historien et critique d’art
Médiateur culturel.
Photos : Dr